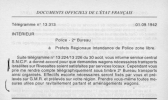Le Conseil d’État indiquait en effet, dans un considérant inutile à la résolution de l’affaire que « si le décret attaqué a ainsi entendu reconnaître les souffrances endurées par les orphelins de certaines victimes de la déportation, il ne modifie pas les conditions dans lesquelles les personnes qui s’y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l’Etat ».
Un an après, le Conseil d’État ordonnait à l’État de prendre en charge la moitié des indemnités dues par Papon à ses victimes [2] et l’on pouvait donc s’attendre légitimement à ce que les victimes soient aussi bien traitées que le bourreau.
Le Conseil d’État avait ouvert une porte, il vient de la claquer brutalement.
Par un avis n° 315499 du 16 février 2009, le Conseil d’État a rendu un avis contentieux selon lequel la question de la prescriptibilité et celle du point de départ de la prescription pour l’action en réparation du fait de la participation de Vichy à un crime contre l’humanité étaient sans objet car…tous les préjudices ont été réparés.
Un avis incompréhensible
La simple lecture de la liste des indemnités établie par le gouvernement et citée par le Conseil d’État montre que c’est totalement faux. Des sous-catégories de victimes n’ont rien perçu faute de rentrer dans aucun des cas envisagés, en raison de leur nationalité, de leur lien de parenté avec les morts ou d’autres causes encore. Sauf peut-être en ce qui concerne la restitution des biens (ce qui n’est pas l’objet des procès en cours), aucune victime n’a reçu des sommes comparables à ce qu’elle aurait reçu si elle avait été victime de n’importe quelle autre infraction, aucune n’a reçu ce qu’ont reçu les victimes de Papon.
De plus, la simple lecture d’un quelconque manuel de droit administratif apprend que lorsque des réparations sont versées par l’administration, les juges conservent le pouvoir et le devoir d’apprécier le préjudice, devant simplement déduire les indemnités déjà versées.
L’avis du Conseil d’État rend d’autant plus perplexe qu’il ne correspond pas exactement aux questions du tribunal administratif de Paris, qui portaient sur les chefs de préjudices indemnisables et sur la déductibilité des sommes versées dans le cadre de régimes de solidarité. La réponse est d’autant plus étonnante que l’État n’a jamais soutenu que tous les préjudices avaient été indemnisés, de sorte qu’il est permis de se demander si le rapporteur public devant le Conseil d’État n’a pas soulevé d’office ce moyen sans en avertir les parties, procédé déloyal à l’évidence contraire au droit au procès équitable.
Les victimes auraient sans aucun doute préféré qu’on leur dise que c’était trop tard, même si quand il était temps, l’action en justice était impossible. Affirmer sans les vérifications individuelles relevant normalement des tribunaux administratifs que toutes les victimes ont été intégralement indemnisées de tous les préjudices, alors que ce n’est pas vrai, risque d’encourager les clichés antisémites sur le rapport à l’argent, en faisant accroire qu’ils reposeraient sur une part de vérité. Le Conseil d’État a pris le risque d’inciter certains à penser qu’ils en veulent toujours plus.
Parmi toutes les motivations possibles d’un avis défavorable aux victimes, le Conseil d’État a donc choisi la pire.
Certes, il semble compenser partiellement en innovant sur le thème de la réparation symbolique puisqu’il considère que « la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites (…) appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes ». D’abord, cela eût été plus convaincant si le Conseil d’État avait fait quelque déclaration, sur son propre rôle sous Vichy et sur son refus d’appliquer, après-guerre, le droit commun aux victimes de Vichy.…
Mais surtout, englober le préjudice de chacun dans un préjudice collectif, c’est nier la singularité de chaque victime, notamment de celles qui ne s’identifient pas à la communauté juive et à ses institutions. Or, c’est bien ce fait le Conseil d’État en prétendant faussement que les préjudices individuels ont déjà été réparés.
Quelques espoirs
Est-il permis de désespérer pour autant ? peut-être pas. Les juridictions du fond restent saisies des litiges, la Cour européenne des droits de l’Homme pourra l’être, le Conseil d’État juge de cassation conserve théoriquement son indépendance.
Le juge administratif
Les juridictions du fond (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) ne sont pas liées par l’avis contentieux rendu par le Conseil d’État.
Elles le sont d’autant moins que la technique de l’avis contentieux, déjà discutable dans son principe même, l’est encore davantage lorsque la juridiction suprême saisie d’une demande d’avis, loin de rendre, comme la loi le prévoit, un avis abstrait sur une question d’interprétation d’une règle de droit, se livre à des appréciations de fait sur ce qui a été indemnisé ou non, alors même que saisie d’une seule affaire, elle est dans l’incapacité matérielle et juridique d’identifier toutes les situations existantes.
En droit, rien n’interdit aux tribunaux administratifs d’exercer pleinement leur fonction de juge dans les nombreux litiges en cours. En fait, rien ne l’interdit non plus, car comment le Conseil d’État pourra-il casser des arrêts prenant en compte des préjudices non réparés, ou partiellement réparés, sans excéder son rôle de cassation et sans empiéter sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ? C’est d’ailleurs ce qu’avait fait le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 6 juin 2006 (consorts Lipietz), que l’État alors dirigé par le président Chirac avait accepté puisqu’il n’avait pas fait appel.
On peut donc espérer que les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, qui restent saisis de nombreux litiges, tiennent l’avis du Conseil d’État pour ce qu’il est et qu’il doit être : un avis, pas un arrêt.
La Cour européenne des droits de l’Homme
Des espérances légitimes ont été brisées. La Cour de Strasbourg pourrait être saisie sur les thèmes du droit au procès équitable et du droit au respect des biens. Il est notamment permis de penser que l’avis fait largement fi du principe selon lequel la justice implique l’indemnisation intégrale du préjudice.
Il y a quelques semaines à peine, le Conseil d’État communiquait sur le changement de dénomination du commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public. Il soulignait que l’indépendance du commissaire du gouvernement justifiait que l’on changeât un nom incompris. L’audition du rapporteur public dans cette affaire, la première importante rendue depuis la réforme, puis la lecture de l’avis contentieux et de son communiqué de presse font douter que le changement de dénomination ait apporté la moindre amélioration. Alors que l’État n’avait pas pris d’avocat, le rapporteur public a pris le vêtement d’un commissionnaire du gouvernement plus soucieux de raison d’État que de Justice.
Le Conseil d’État peinait à éteindre les doutes sur la conformité du commissaire du gouvernement aux standards du procès équitable. L’avis du 16 février 2009 en suscite encore davantage sur le rapporteur public.
Le Conseil d’État juge de cassation
Est-il permis d’espérer que le Conseil d’État juge de cassation ne s’alignera pas sur son avis ? À priori, il est hautement improbable que le Conseil d’État juge de cassation confirme une éventuelle résistance des juges du fond à l’application d’un avis contentieux du Conseil d’État. Cela ne s’est jamais vu, mais c’est juridiquement possible, d’autant que sauf à violer le droit au procès équitable, il ne serait pas concevable que la formation de cassation comporte un juge ayant contribué à l’avis du 16 février 2009.
Il faut donc encore essayer de convaincre que les victimes de Vichy ont le droit de bénéficier des règles de droit commun, qui régissent l’indemnisation de tous les préjudices et l’imputation des indemnités.
L’avenir des juridictions administratives
L’administrativiste que je suis, a toujours défendu la thèse, il est vrai banale, que l’existence d’une juridiction administrative séparée contribuait à la protection des libertés publiques et que le commissaire du gouvernement était effectivement indépendant.
Je pensais aussi que le Conseil d’État avait acquis cette indépendance que les libéraux lui ont longtemps contestée et que certains lui contestent encore. Je pensais que les adversaires d’une juridiction administrative séparée surestimaient l’importance des résidus de l’institution impériale. Je pensais que l’on pouvait s’accommoder du cumul de la fonction de conseiller juridique de l’État avec celle de juge administratif suprême, pour peu que des précautions fussent prises, et je pensais qu’elles étaient prises.
Je pensais aussi que le commissaire du gouvernement méritait d’être sauvé des foudres de la Cour européenne des droits de l’Homme, que seule sa désignation était inappropriée.
Je pensais encore que les avantages d’une juridiction administrative ne se limitaient pas à ceux, sommes toutes mineurs, d’une spécialisation justifiée par l’existence d’un droit plus ou moins différent. Cet avis contentieux me fait radicalement douter de mon opinion.
Je doute de plus en plus que soit fondée cette vision du Conseil d’État comme deuxième garant des libertés publiques, pourtant menacées par des législations et réglementations multiples : prélèvements d’ADN, fichiers informatiques, vidéo-surveillance, carte Navigo ou Vitale, passeport sécurisé, législation anti-terroriste etc.
J’avais commencé à douter de l’utilité de la juridiction administrative à la lecture de quelques arrêts que je voulais toujours croire d’espèce, qu’il s’agisse d’arrêts sur le couvre-feu, de certains arrêts sur les étrangers, et d’autres encore. L’arrêt [3] par lequel le Conseil d’État avait jugé que la SNCF n’exerçait pas de prérogatives de puissance publique quand elle faisait voyager des Juifs dans les conditions que l’on sait avait accru mes doutes, surtout comparé à la jurisprudence sur les sociétés canines qui, elles, exercent des prérogatives de puissance publique illicites quand elles prétendent interdire les concours de beauté aux chiens dont les oreilles ont été mutilées par des maîtres indignes [4].
Je ne bascule pas pour autant dans le camp de ceux qui prônent le placement des juridictions administratives sous le contrôle de la cour de cassation, ou qui souhaitent la diminution drastique de leur compétence, voire leur suppression.
Mais il me semble que cet avis démontre combien il est impérieux de créer une juridiction administrative suprême distincte du Conseil d’État, conseiller du gouvernement. Il faudrait que ses juges soient enfin des magistrats, comme le sont devenus ceux des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et non de hauts fonctionnaires, dont la vocation est de conseiller les pouvoirs publics.
Persister dans la configuration actuelle serait exposer le Conseil d’État à un arrêt comparable à celui qui a frappé son homologue luxembourgeois [5].
Mais il est vrai que l’on peut encore espérer que le Conseil d’État saura se ressaisir, qu’un arrêt de cassation me donnera tort de douter, qu’absolument toutes les victimes de Vichy seront indemnisées comme toutes les victimes.
On peut encore espérer que le sens de la Justice l’emporte sur la raison d’État.
 Hélène Lipietz
Ancienne Sénatrice de Seine-et-Marne
Hélène Lipietz
Ancienne Sénatrice de Seine-et-Marne